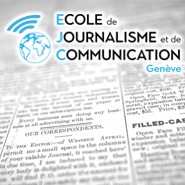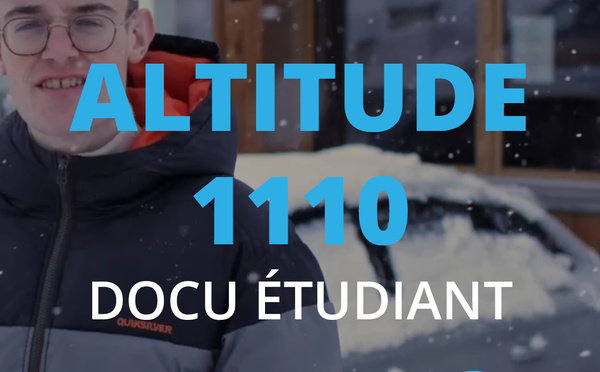Les rues genevoises, entre espace d’expression et espace de tension
Un samedi d’octobre dans les rues de la ville, des
drapeaux palestiniens sont brandis par les foules tandis
que des slogans résonnent à travers les rues.
En 2025, l’important nombre de manifestations liées au
conflit israélo-palestinien souligne la vitalité démocratique
de Genève, ville dépositaire des Droits de l’Homme et
ville démocratique ou l’expression populaire a une place
singulière. Manifester en Suisse est un droit fondamental
garanti par la constitution.
A Genève, ce droit est quasi partie intégrante de la
culture sociale et politique, mais derrière l’engagement
toujours plus important de la population genevoise dans ce genre d’action, des tensions
apparaissent. Les autorités se veulent tolérantes mais continuent de craindre des
débordements; il suffit de quelques heurts, de quelques écarts ou de propos virulents relayés
par les réseaux sociaux … pour que la légitimité d’un mouvement se voit fragilisée.
Certains passants expriment leur malaise : “On comprend la cause mais parfois cela devient
trop politique. On a l’impression que le conflit s’importe chez nous.”
D’autres au contraire saluent et encouragent l’engagement citoyen face à un monde qui ferme
les yeux. Le collectif XR Familles déclare : “ Quel message transmettons-nous à nos enfants si
nous nous taisons ou nous résignons, alors que nous bénéficions de tant de privilèges? Leur
montrer notre opposition à de pareilles horreurs nous paraît la moindre des choses à faire.”
drapeaux palestiniens sont brandis par les foules tandis
que des slogans résonnent à travers les rues.
En 2025, l’important nombre de manifestations liées au
conflit israélo-palestinien souligne la vitalité démocratique
de Genève, ville dépositaire des Droits de l’Homme et
ville démocratique ou l’expression populaire a une place
singulière. Manifester en Suisse est un droit fondamental
garanti par la constitution.
A Genève, ce droit est quasi partie intégrante de la
culture sociale et politique, mais derrière l’engagement
toujours plus important de la population genevoise dans ce genre d’action, des tensions
apparaissent. Les autorités se veulent tolérantes mais continuent de craindre des
débordements; il suffit de quelques heurts, de quelques écarts ou de propos virulents relayés
par les réseaux sociaux … pour que la légitimité d’un mouvement se voit fragilisée.
Certains passants expriment leur malaise : “On comprend la cause mais parfois cela devient
trop politique. On a l’impression que le conflit s’importe chez nous.”
D’autres au contraire saluent et encouragent l’engagement citoyen face à un monde qui ferme
les yeux. Le collectif XR Familles déclare : “ Quel message transmettons-nous à nos enfants si
nous nous taisons ou nous résignons, alors que nous bénéficions de tant de privilèges? Leur
montrer notre opposition à de pareilles horreurs nous paraît la moindre des choses à faire.”
Un outil démocratique traditionnel mais réglementé
Même si manifester est un droit démocratique et constitutionnel, en Suisse, cette pratique est
très réglementée. Les autorités genevoises, par exemple, exigent une demande préalable pour
toute manifestation sur la voie publique. Les forces de l’ordre sont chargées de veiller au bon
déroulement de ces rassemblements citoyens ainsi qu’au respect des droits et de la sécurité de
chacun. Lorsqu’une manifestation dégénère, l’intention initiale peut être mal interprétée. Divers
débordements (dégradations matérielles, blocages de routes, tensions avec la police, …)
alimentent souvent un discours médiatique négatif, réduisant aux yeux du public la crédibilité de
la cause.
La question se pose alors de savoir qui porte la responsabilité de ces débordements (Les
manifestants ? Les autorités ? Les contre-manifestants ? Les participants indésirables tels que
les black-blocks, Les passants ? …).
très réglementée. Les autorités genevoises, par exemple, exigent une demande préalable pour
toute manifestation sur la voie publique. Les forces de l’ordre sont chargées de veiller au bon
déroulement de ces rassemblements citoyens ainsi qu’au respect des droits et de la sécurité de
chacun. Lorsqu’une manifestation dégénère, l’intention initiale peut être mal interprétée. Divers
débordements (dégradations matérielles, blocages de routes, tensions avec la police, …)
alimentent souvent un discours médiatique négatif, réduisant aux yeux du public la crédibilité de
la cause.
La question se pose alors de savoir qui porte la responsabilité de ces débordements (Les
manifestants ? Les autorités ? Les contre-manifestants ? Les participants indésirables tels que
les black-blocks, Les passants ? …).
La solidarité face à la radicalité
Pour beaucoup, prendre part à ces rassemblements en faveur de la Palestine est avant tout un
geste de solidarité, un témoignage d’empathie envers des civils et une dénonciation des
violences tout en rappelant le droit humanitaire international. Pour eux, manifester est
également un moyen concret de refuser l'indifférence. Pour certains, cette expression de
solidarité traduit une politisation excessive. Manifester serait un biais pour s’exprimer
politiquement.
Espace académique et politisation ?
A l’université de Genève (UNIGE) où plusieurs débats enflammés ont eu lieu, des avis partagés ont été perceptibles. Des étudiants pro-palestiniens dénonçaient le silence du rectorat quant à la collaboration académique avec des institutions israéliennes. Pour certains, l’université
reste un lieu de débat et de réflexion, un lieu où la contestation peut et doit s’inscrire dans un cadre académique et où s’exercent réflexion et sens critique. Pour d’autres, ces rassemblements prennent parfois des allures d’instrumentalisation politique polarisant les opinions et alimentant des tensions. Si certains rassemblements étudiants incarnent l’idée de défendre la liberté d’expression en milieu académique et soutiennent des populations en détresse, d’autres préfèrent “réfléchir aux meilleurs moyens d’agir sans que cela ne sanctionne ceux qui n’ont rien demandé”, comme l’a expliqué une étudiante de l’UNIGE
geste de solidarité, un témoignage d’empathie envers des civils et une dénonciation des
violences tout en rappelant le droit humanitaire international. Pour eux, manifester est
également un moyen concret de refuser l'indifférence. Pour certains, cette expression de
solidarité traduit une politisation excessive. Manifester serait un biais pour s’exprimer
politiquement.
Espace académique et politisation ?
A l’université de Genève (UNIGE) où plusieurs débats enflammés ont eu lieu, des avis partagés ont été perceptibles. Des étudiants pro-palestiniens dénonçaient le silence du rectorat quant à la collaboration académique avec des institutions israéliennes. Pour certains, l’université
reste un lieu de débat et de réflexion, un lieu où la contestation peut et doit s’inscrire dans un cadre académique et où s’exercent réflexion et sens critique. Pour d’autres, ces rassemblements prennent parfois des allures d’instrumentalisation politique polarisant les opinions et alimentant des tensions. Si certains rassemblements étudiants incarnent l’idée de défendre la liberté d’expression en milieu académique et soutiennent des populations en détresse, d’autres préfèrent “réfléchir aux meilleurs moyens d’agir sans que cela ne sanctionne ceux qui n’ont rien demandé”, comme l’a expliqué une étudiante de l’UNIGE
Différents mais parfois confondus
Les critiques les plus dures accusent ces mobilisations de permettre des discours haineux.
D’autant plus lorsqu’apparaissent des slogans perçus comme hostiles envers la population
israélienne. Le sens du mot pro-palestinien devient ténu, parfois entendu comme anti-israélien -
voire antisémite. Ces amalgames pèsent sur les militants qui souhaitent défendre la dignité
humaine, et éviter de s’attaquer à une population.
Certains observateurs craignent que des actions initialement humanitaires ne dérivent vers des
positions plus radicales. Les risques de militantisme et de polarisation rendent difficile la conciliation entre engagements citoyens et responsabilité de l’espace public. Si pour des
étudiants, participer à ces manifestations relève d’un engagement social, pour certains
passants ces rassemblements paraissent déroutants, voire polarisants, notamment lorsque des
débordements surviennent.
Les manifestations pour la Palestine relèvent d’un enjeu d’actualité important, défendre une
cause sans qu’elle ne soit perçue comme une radicalisation.
Entre humanisme, militantisme et polarisation des idées et mouvements, les voix de la rue
reflètent la complexité de l’engagement citoyen à Genève, complexité à laquelle les autorités
doivent faire face.
D’autant plus lorsqu’apparaissent des slogans perçus comme hostiles envers la population
israélienne. Le sens du mot pro-palestinien devient ténu, parfois entendu comme anti-israélien -
voire antisémite. Ces amalgames pèsent sur les militants qui souhaitent défendre la dignité
humaine, et éviter de s’attaquer à une population.
Certains observateurs craignent que des actions initialement humanitaires ne dérivent vers des
positions plus radicales. Les risques de militantisme et de polarisation rendent difficile la conciliation entre engagements citoyens et responsabilité de l’espace public. Si pour des
étudiants, participer à ces manifestations relève d’un engagement social, pour certains
passants ces rassemblements paraissent déroutants, voire polarisants, notamment lorsque des
débordements surviennent.
Les manifestations pour la Palestine relèvent d’un enjeu d’actualité important, défendre une
cause sans qu’elle ne soit perçue comme une radicalisation.
Entre humanisme, militantisme et polarisation des idées et mouvements, les voix de la rue
reflètent la complexité de l’engagement citoyen à Genève, complexité à laquelle les autorités
doivent faire face.
Le positionnement des pouvoirs publics
A Genève, Ville Monde, les manifestations sont un outil essentiel à la démocratie comme dans
le reste de la Suisse. Mais la manière dont les pouvoirs publics se placent et réagissent à ces
rassemblements citoyens montre les limites de cet outil démocratique. La liberté d’expression
est en jeu. Quelles sont ses limites ?
Aujourd’hui, la plupart des manifestations sont autorisées, à condition que ces dernières restent
pacifiques. Chaque autorisation est minutieusement évaluée; il s’agit de gérer stratégie les
foules, calculer les risques de débordement, coordonner la police et les différents services
concernés, rassurer la population, … Les autorités genevoises restent pourtant dans une
situation délicate. Elles souhaitent affirmer leur attachement au droit à la liberté d’expression et
au droit à manifester, piliers de la démocratie suisse. Ces dernières se doivent également de
veiller à la sécurité publique et à la réputation internationale d’une ville qui abrite les Nations
Unies, le Conseil des droits de l’Homme ainsi que de nombreuses ONG.
le reste de la Suisse. Mais la manière dont les pouvoirs publics se placent et réagissent à ces
rassemblements citoyens montre les limites de cet outil démocratique. La liberté d’expression
est en jeu. Quelles sont ses limites ?
Aujourd’hui, la plupart des manifestations sont autorisées, à condition que ces dernières restent
pacifiques. Chaque autorisation est minutieusement évaluée; il s’agit de gérer stratégie les
foules, calculer les risques de débordement, coordonner la police et les différents services
concernés, rassurer la population, … Les autorités genevoises restent pourtant dans une
situation délicate. Elles souhaitent affirmer leur attachement au droit à la liberté d’expression et
au droit à manifester, piliers de la démocratie suisse. Ces dernières se doivent également de
veiller à la sécurité publique et à la réputation internationale d’une ville qui abrite les Nations
Unies, le Conseil des droits de l’Homme ainsi que de nombreuses ONG.
Echanges animés
Pour beaucoup de manifestants, la police réagit parfois de manière “excessive” lors de ces
rassemblements. “ C’était dingue de se dire que ça se passait chez nous [à Genève], je n’aurais jamais imaginé que la police puisse agir comme ça” partage Ismaël, un citoyen actif, en parlant de la manifestation du 2 octobre à laquelle il a participé. “ Des gazs lacrymogènes ?!”
Lorsque des débordements surviennent, comme celui du 2 octobre, les critiques ne sont jamais
loin et beaucoup parlent de “chaos” et de “violences policières injustifiées”. Des associations
comme Amnesty International Suisse ont demandé une enquête indépendante pour évaluer si
la réponse policière était proportionnée. La conseillère d’État Carole-Anne Kast a défendu
l’intervention en affirmant que “la contrainte était nécessaire” pour faire face à un petit groupe
de manifestants violents (un groupe d’environ 150 black-blocks). Plusieurs autres voix
rappellent que même les manifestations spontanées doivent être protégées par les autorités.
Quelques rares personnes comprennent, elles, la réponse parfois musclée des groupes
d’intervention : “ Les policiers ne font que leur travail, ils respectent et font respecter la loi.”
explique Laure, passante ayant assisté à la collision du 2 octobre.
Cette dynamique illustre ainsi la complexité de la gestion des manifestations : il faut concilier
sécurité, liberté d’expression et neutralité, tout en tenant compte des différentes perceptions
citoyennes. Dans ce cadre, la rue devient un espace où la démocratie se vit, mais où les
pouvoirs publics doivent rester attentifs à l’équilibre fragile entre ordre public et expression
citoyenne.
rassemblements. “ C’était dingue de se dire que ça se passait chez nous [à Genève], je n’aurais jamais imaginé que la police puisse agir comme ça” partage Ismaël, un citoyen actif, en parlant de la manifestation du 2 octobre à laquelle il a participé. “ Des gazs lacrymogènes ?!”
Lorsque des débordements surviennent, comme celui du 2 octobre, les critiques ne sont jamais
loin et beaucoup parlent de “chaos” et de “violences policières injustifiées”. Des associations
comme Amnesty International Suisse ont demandé une enquête indépendante pour évaluer si
la réponse policière était proportionnée. La conseillère d’État Carole-Anne Kast a défendu
l’intervention en affirmant que “la contrainte était nécessaire” pour faire face à un petit groupe
de manifestants violents (un groupe d’environ 150 black-blocks). Plusieurs autres voix
rappellent que même les manifestations spontanées doivent être protégées par les autorités.
Quelques rares personnes comprennent, elles, la réponse parfois musclée des groupes
d’intervention : “ Les policiers ne font que leur travail, ils respectent et font respecter la loi.”
explique Laure, passante ayant assisté à la collision du 2 octobre.
Cette dynamique illustre ainsi la complexité de la gestion des manifestations : il faut concilier
sécurité, liberté d’expression et neutralité, tout en tenant compte des différentes perceptions
citoyennes. Dans ce cadre, la rue devient un espace où la démocratie se vit, mais où les
pouvoirs publics doivent rester attentifs à l’équilibre fragile entre ordre public et expression
citoyenne.
La Cité de Calvin, aujourd’hui
Les mobilisations pro-palestiniennes traduisent la tension constante entre maintien de l’ordre
public et liberté d'expression révélant les limites de cette liberté parfois mise à l’épreuve. Dans
une ville symbole du dialogue international et des droits humains, la rue devient un miroir
sociétal : un lieu d’engagement, mais aussi de confrontation d’opinions. Si pour beaucoup, ces
rassemblements incarnent un devoir moral et humanitaire face aux souffrances du peuple
palestinien, d’autres y voient une dérive militante ou une menace pour la cohésion sociale.
Genève doit composer avec une opinion publique divisée. Une scène militante de plus en plus
active. Dans ce contexte, la question est ouverte : comment continuer à favoriser le débat sans
que l’expression citoyenne ne devienne source de fracture ? À Genève, plus que jamais, la
démocratie se passe également dans les rues.
Si l’évolution récente de la situation au Proche-Orient (accords de cessez-le-feu le 9
octobre,sommet de la paix sous l’impulsion de Trump le 13 octobre, libération d’otages
israéliens, et de prisonniers palestiniens) a permis un répit après deux années de guerre.
Toutefois, les tensions héritées de ce conflit séculaire ne sont pas encore apaisées. La situation
humanitaire reste extrêmement précaire tandis que des violences continuent toujours en
Cisjordanie, rappelant la nécessité de poursuivre les efforts de solidarité et de rechercher des
solutions durables.
Reste à savoir si cet apaisement au Moyen-Orient permettra, à la Genève et aux manifestants,
de relâcher la pression.
public et liberté d'expression révélant les limites de cette liberté parfois mise à l’épreuve. Dans
une ville symbole du dialogue international et des droits humains, la rue devient un miroir
sociétal : un lieu d’engagement, mais aussi de confrontation d’opinions. Si pour beaucoup, ces
rassemblements incarnent un devoir moral et humanitaire face aux souffrances du peuple
palestinien, d’autres y voient une dérive militante ou une menace pour la cohésion sociale.
Genève doit composer avec une opinion publique divisée. Une scène militante de plus en plus
active. Dans ce contexte, la question est ouverte : comment continuer à favoriser le débat sans
que l’expression citoyenne ne devienne source de fracture ? À Genève, plus que jamais, la
démocratie se passe également dans les rues.
Si l’évolution récente de la situation au Proche-Orient (accords de cessez-le-feu le 9
octobre,sommet de la paix sous l’impulsion de Trump le 13 octobre, libération d’otages
israéliens, et de prisonniers palestiniens) a permis un répit après deux années de guerre.
Toutefois, les tensions héritées de ce conflit séculaire ne sont pas encore apaisées. La situation
humanitaire reste extrêmement précaire tandis que des violences continuent toujours en
Cisjordanie, rappelant la nécessité de poursuivre les efforts de solidarité et de rechercher des
solutions durables.
Reste à savoir si cet apaisement au Moyen-Orient permettra, à la Genève et aux manifestants,
de relâcher la pression.